
« Collection de sable » d'Italo Calvino
(Gallimard, coll. Folio, Paris, 2014)
Quel sens les objets prennent-ils dès lors qu'ils deviennent des objets de collection ?
Voilà sans nul doute la principale réflexion vers laquelle nous entraîne Italo Calvino dans la quarantaine de chroniques réunies sous le nom générique de la première d'entre elles. Dans ce recueil, l'auteur de la célèbre trilogie Le vicomte pourfendu, Le baron perché et Le chevalier inexistant nous convie en effet à l'accompagner tout au long des commentaires dont il dote les objets qui l'ont particulièrement attirés, tels le mihrab, cette niche présente dans les mosquées qui indique la direction de La Mecque, le pachinko, ce jeu d'adresse multicoloré japonais, les automates du XVIIIe siècle ou encore les arbres (naturels comme l'arbre du Tula, planté près d'Oaxaca au Mexique ou créations d'artiste comme l'arbre de Jessé découvert dans la même ville). On sait qu'il fut particulièrement féru de ces derniers vu sa formation d'agronome et son goût pour la botanique (disciplines héritées respectivement du métier de son père et de la profession de sa mère).
Tantôt l'auteur scrute avec soin des méga-objets : une porcherie dans une villa romaine, la colonne Trajane, des jardins zen ; tantôt il décortique les passions vécues par certains collectionneurs, qu'il s'agisse de philatélistes conjuguant l'amour des choses exotiques et l'intérêt des séries, ou des accumulateurs de masques à gaz, ces derniers apparaissant aujourd'hui à ses yeux comme « un dispositif anthropomorphe » ou même « un élément de vengeance contre les guerres ».
Dans chacun des cas abordés, Italo Calvino propose plusieurs interprétations, fournit un ensemble de lectures, une multitude de regards… Une ouverture vers une pluralité de sens, qui fort heureusement l'empêche de clôturer définitivement sa chronique ou amène cette dernière vers un au-delà des objets et des pratiques, vers le transcendantal, le merveilleux ou le spirituel. En cela les objets qu'il présente acquièrent-ils souvent pour le lecteur attentif un statut de support à la méditation.
Dans ce contexte, il n'est pas étonnant qu'une de ses chroniques soit consacrée à Mario Praz, ce passionné de mobilier ancien et d'objets de décoration intérieure, qui appréciait davantage les meubles Empire que les paysages. « Et pourtant, écrit à ce propos Calvino, la contemplation des paysages naturels passe pour être ce qu'il y a de plus spirituel : pour quelle raison, alors, non pas celle des meubles ? » (p.181).
Calvino s'interroge aussi sur quelques figures parmi les plus extravagantes du collectionnisme, qu'il s'agisse du Docteur Spitzner, pratiquant une « pédagogie de l'horreur » par l'exposition itinérante de sa « collection de monstres » constituée de mannequins en cire ; de Daniel Evans, inventeur de séries de timbres de pays imaginaires ; ou encore de membres de l'Académie celtique soucieux de recenser la vingtaine de dragons célébrés en France, relatant les légendes tournant autour des mêmes thèmes : « les offrandes de jeunes filles au monstre, la délivrance de la part d'un saint ou d'une sainte » (p.58).
Si, à ses yeux, « le collectionnisme () redonne une unité et un sens d'ensemble homogène à la dispersion des choses » et si « la possession aide à atteindre cette finalité (à savoir l'identification, le fait de se reconnaître dans l'objet) parce qu'elle permet l'observation prolongée, la contemplation, la vie en commun, la symbiose » (p.183), il n'en rejette pas pour autant un regard davantage mélancolique quand il évoque « Charles Quint, vieux et malade, en train de se promener dans le couvent de l'Estramadure au milieu du tic-tac des horloges de sa collection, et Mazarin, déposé et exilé, qui erre la nuit au milieu des tableaux de sa pinacothèque, en leur disant adieu » (p.185).
Même si le livre est surtout empreint de mélancolie, un regard amer parcourt parfois ses chroniques, notamment quand il s'arrête sur le rôle des collections particulières, des musées régionaux et « des parcs régionaux » dans la sauvegarde des patrimoines et des milieux. « Seule l'image de l'intérêt matériel peut sans doute contrebalancer l'élan qui pousse l'homme contemporain à accomplir ce geste instinctif : jeter » (p.63).
Quoi de plus friable, voire de plus insensé qu'une collection de sables dont on sait qu'une fois extraits de leur environnement, ils perdent toute signification initiale et se vident de leur substance ! « Sans l'indigo de la mer, le scintillement de cette plage de coquillage broyés s'est perdu; () rien n'est resté de la chaleur humide de l'oued dans le sable figé; () loin du Mexique, le sable mélangé à la lave du volcan Paricutin n'est qu'une poussière noire semblable à celle qui tombe d'une cheminée ramonée » (p.15).
Mais voilà qu'émerge un sens nouveau que saisit le collectionneur – ou plus précisément la collectionneuse – de sable : « toucher la structure de silice de l'existence », « comprendre la signification du gris » dès lors que chaque gris évoqué par l'ensemble des grains de sable n'est plus perçu comme gris.
Le créateur de mots est confronté au même processus de modification que le collectionneur. « Peut-être est-ce en fixant le sable en tant que sable, les mots en tant que mots, que nous pourrons être près de comprendre comment et en quelle mesure le monde érodé et broyé peut encore trouver là son fondement et son modèle » (p.17).
De même, les temples, les villas et les palais japonais construits en bois et les jardins sont éminemment périssables. Frappés par l'âge ou par les incendies et les tempêtes, ils disparaissent en tant qu'objets singuliers. Mais leur structure reste et résiste : « la matière dans laquelle il(s) (sont) bâti(s), la facilité avec laquelle on peut les défaire, puis le(s) refaire à l'identique suffisent pour démontrer que tous les éléments de l'univers peuvent tomber l'un après l'autre, mais que quelque chose reste malgré tout » (p.271).
Axel Gryspeerdt
février 2019
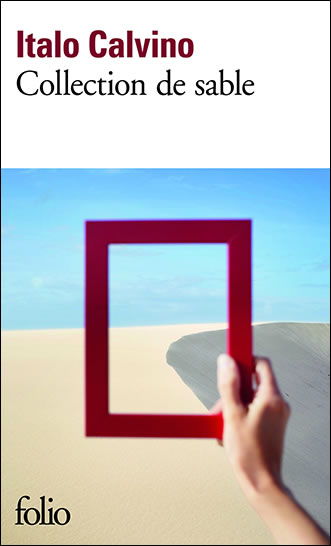
|
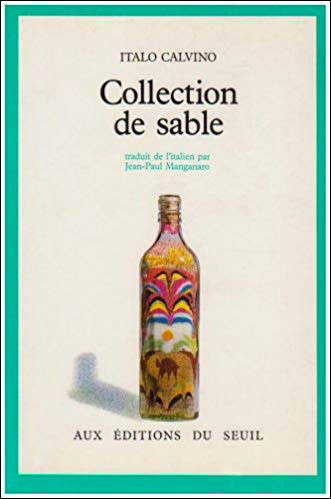
|

|
© 2012 collectiana.org - Fondation pour l'étude et le développement des collections d'art et de culture - Fondation d'utilité publique - Tous droits réservés







